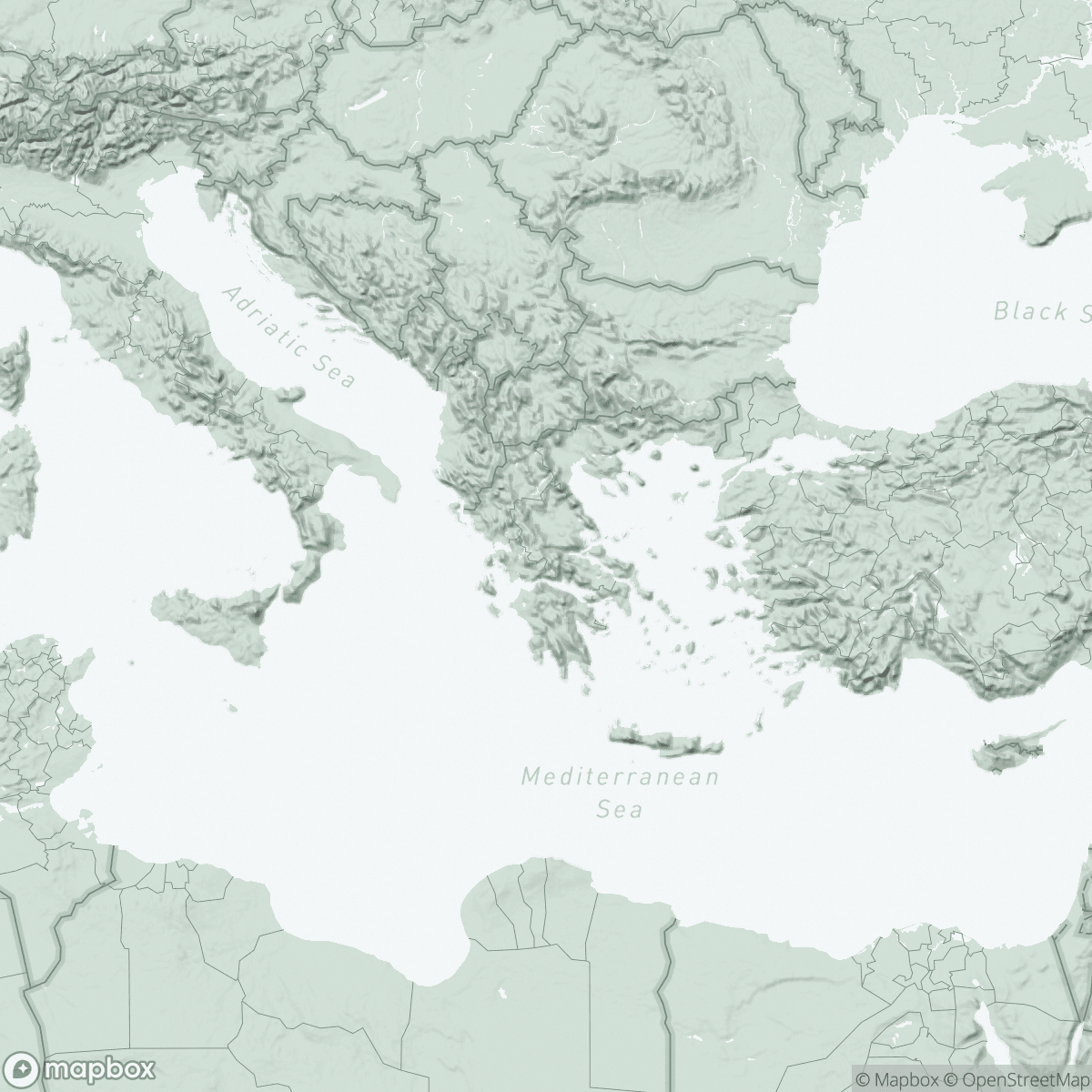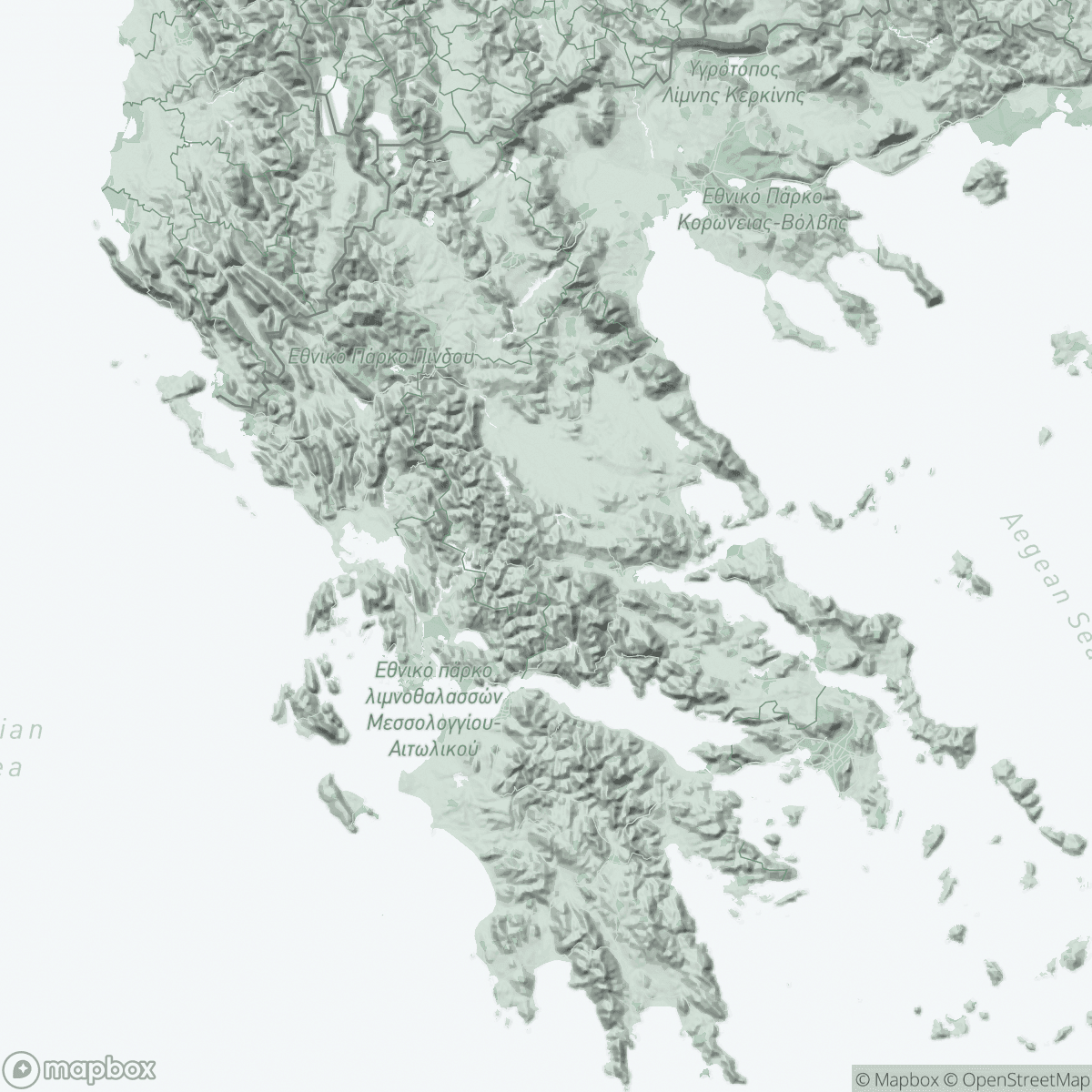Que se passe-t-il après l'échec ? Gérer les personnes déplacées en Grèce et en Europe
En 1 clic, aidez-nous à diffuser cette information :
Par Christina Psarra, directrice exécutive de MSF en Grèce
Début juillet, l'arrivée de plus de 2 500 personnes demandant l’asile en Crète était un rappel brutal qu'aucune politique de dissuasion, ni aucune menace de détention après leur arrivée sur le sol européen, n'empêchera les personnes fuyant les violences liées aux conflits ou une misère absolue de chercher sécurité et protection.
Fidèles à leur mission d'alléger les souffrances et de garantir la dignité des personnes touchées par des crises potentiellement mortelles, les équipes de Médecins sans Frontières (MSF) ont répondu à l'afflux d'arrivées en Crète en mettant à disposition des consultations médicales et des produits d'hygiène de base.

Néanmoins, le soutien ponctuel apporté par les acteurs humanitaires ne peut masquer les échecs persistants des politiques grecques et européennes face aux populations déplacées depuis plus de dix ans. Le gouvernement grec, une fois de plus totalement pris au dépourvu, a procédé à une suspension des demandes d’asile pour les migrants débarquant sur l’île pendant trois mois, une mesure qui, selon lui, envoyait un « message clair ».
Bien que ce message ait été maintes fois répété, il est dénué de sens pour ceux qui risquent leur vie pour un avenir meilleur, et constitue une position illégale, fallacieuse et dangereuse pour le bon fonctionnement des démocraties.
Aujourd’hui, près d'une personne sur 67 est contrainte de fuir, soit l'équivalent de 123,2 millions de personnes dans le monde.
Les approches obstinées mais vaines de gestion des arrivées par la mer n'ont fait que rendre les itinéraires davantage risqués, et ont aggravé les conditions de vie pour des êtres humains désespérés.
La complaisance politique envers le récit nauséabond d'une « invasion qui conduirait au grand remplacement des Européens » a ancré une mentalité de siège chez les décideurs politiques de toute l'Europe : ils considèrent les populations déplacées fuyant les violences extrêmes et la pauvreté comme un « défi sécuritaire ».
Associée à la criminalisation croissante des organisations de la société civile et des individus cherchant à aider et à protéger les personnes en déplacement, l’impasse actuelle concernant l’arrivée continue de bateaux sur les côtes européennes devrait tous nous obliger à évaluer si les méthodes actuelles de « détention » atteignent réellement leurs objectifs déclarés, à savoir dissuader les populations de risquer leur vie sur des canots pneumatiques pour atteindre ce qu’elles perçoivent comme une porte de sortie des situations infernales auxquelles elles sont confrontées dans leur pays d’origine.
En ce moment, au Soudan, après plus de deux ans de conflit brutal, la population est confrontée à des assauts incessants : des enfants meurent de faim à cause des blocus, des bombes sont larguées sur des zones civiles et des balles sont tirées sur des hôpitaux. L'est du Tchad abrite plus d'un million de réfugiés provenant du Soudan. J'y ai moi-même entendu des mères déguisant leurs garçons en filles pour les sauver la vie. Croit-on vraiment que les politiques coercitives et les risques de détention en Grèce empêcheront des Soudanais désespérés de trouver un moyen de sauver leurs familles ? Mais surtout, avons-nous déjà oublié que, dans la même situation, nous, Grecs, avons fui notre pays pendant la guerre civile et le régime militaire qui a suivi jusqu'en 1974 ? Ou, plus récemment, les pays européens, dont la Grèce, n'ont-ils pas réussi à accueillir et à accorder le statut humanitaire à des milliers d'Ukrainiens ?
Les hommes en bonne santé sont présentés comme des migrants économiques ayant de mauvaises intentions et un esprit criminel, et toute personne venant d'un pays ne connaissant pas l’ampleur massive de guerre au Soudan est automatiquement considérée comme ne fuyant pas la guerre, donc inéligible à l'asile.
Le droit d'asile est un droit individuel.
Si toutes les personnes arrivant en Europe ne se voient pas accorder le statut de réfugié, chacune a le droit de déposer une demande et de voir sa demande examinée équitablement.
En réaction à ce qui se passe à quelques heures de vol d'Athènes, constatons-nous un quelconque engagement de notre gouvernement ou d’autres pays de l'Union Européenne face aux atrocités commises au Soudan ?
Ne devrions-nous pas encourager nos décideurs politiques à œuvrer pour mettre fin à la violence qui pousse tant de personnes cherchant à survivre dans des situations de crise à trouver refuge sur notre continent ?
Il y a beaucoup à dire sur le désintérêt apparent de notre société pour ce qui se passe ailleurs dans le monde, mais les sommes exorbitantes dépensées pour endiguer sans succès les mouvements de population à travers la Méditerranée constituent non seulement un échec moral, une atteinte à notre humanité, mais aussi un échec politique.
Dans un contexte mondial marqué par la multiplication des conflits et la fragilisation du respect du droit international – ces mêmes lois qui assuraient autrefois la survie et la dignité de nos ancêtres il y a quelques générations à peine –, il est impératif moralement de partager notre humanité avec ceux qui luttent aujourd'hui de la même manière.
En tant que médecins, nous ne savons pertinemment qu’aucun de nos mots ni de nos pansements ne résoudra les problèmes politiques et économiques intrinsèques qui poussent les gens à migrer vers l'Europe. Cependant, des concepts comme « solidarité » et « humanité » ne sont pas des mots à la mode destinés à nous donner une meilleure image de nous-mêmes. Ils sont à la base de ce qui fait de nous une société globale, animée de rêves partagés et du désir profond d'améliorer le sort de nos semblables, car nous pourrions avoir besoin que ces valeurs nous soient à nouveau appliquées dans un avenir proche.
Notre monde est connecté, les conflits sont réels, la famine est réelle, le changement climatique est réel, et aucun endroit n'est sûr si nous ne prenons pas tous soin de notre avenir.
Face à la pression incessante qui pèse sur leur bien-être physique et mental, soyons clairs : les réfugiés potentiels ne sont ni une menace ni un fardeau. Ils recherchent la sécurité, la dignité et la possibilité d'exister, tout simplement. Et nous devons exister ensemble.