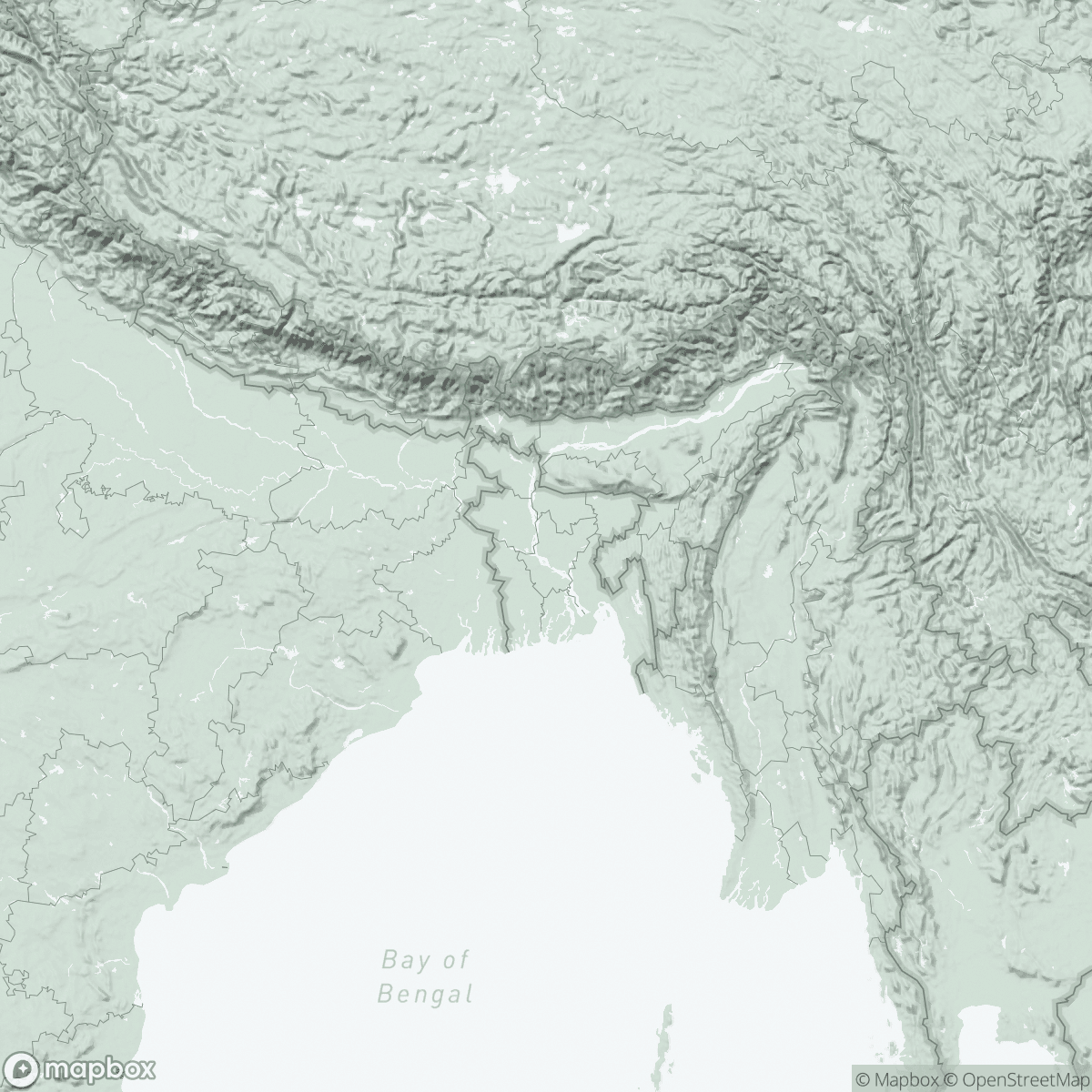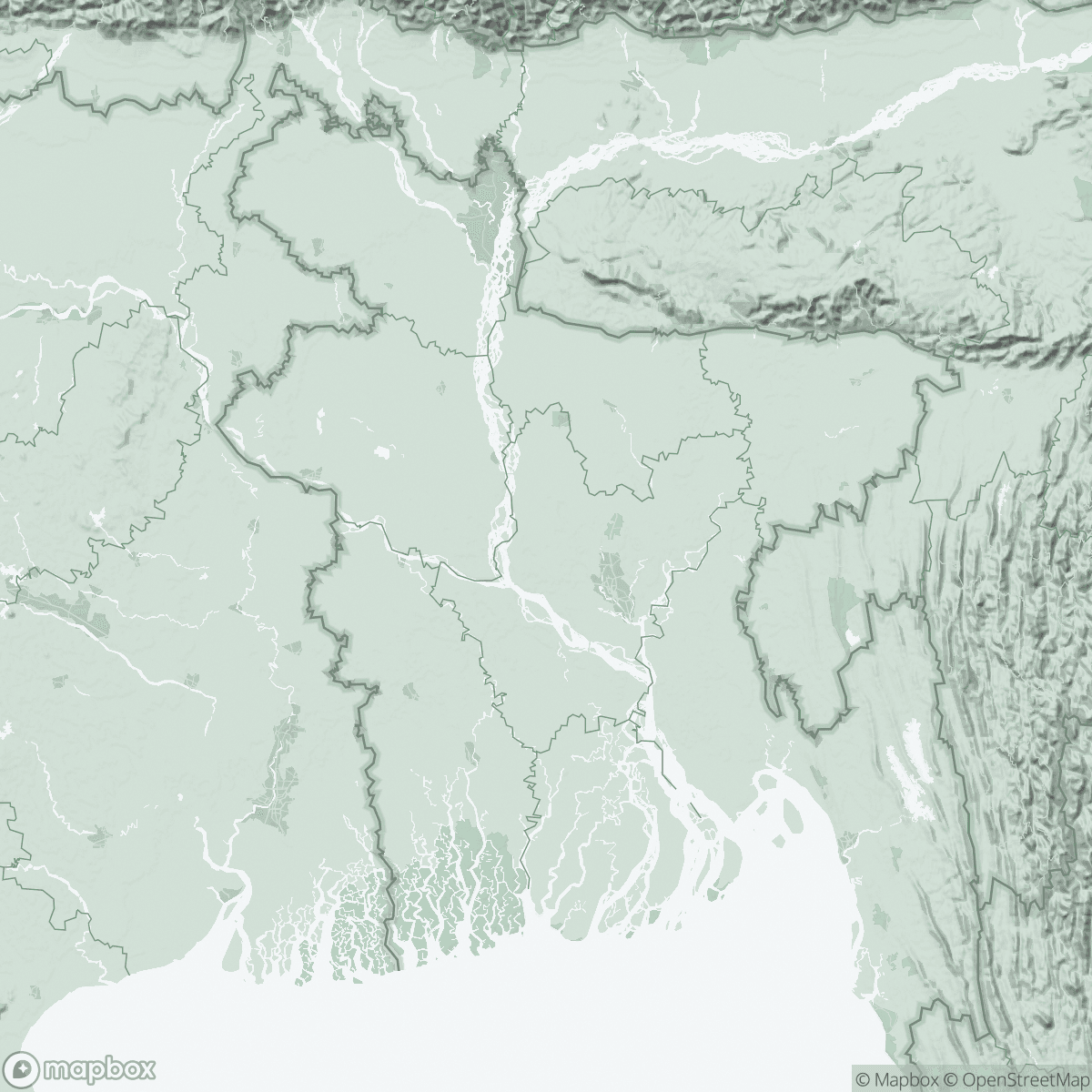5 ans après : 5 Rohingyas parlent de leur passé, présent et futur
En 1 clic, aidez-nous à diffuser cette information :
J'aspire à la paix
Tayeba Begum est mère de six enfants, dont deux jumeaux de cinq ans. Elle a fui le Myanmar en 2017 avec rien d'autre que les vêtements qu'elle portait sur le dos. Maintenant, cinq ans plus tard, Tayeba décrit la vie dans les camps pour les jumeaux et elle-même. Bien qu'elle aspire à rentrer chez elle, elle dit qu'il est difficile de retourner au Myanmar sans savoir si ses droits seraient assurés.
"Mes jumelles, Nur Ankis et Nur Bahar, n'avaient que six mois lorsque nous nous sommes échappés de notre pays natal au Myanmar. J'ai couru avec elles. Tout ce que nous avions avec nous, c'étaient les vêtements que nous portions.
Après le début des tueries, nous ne pouvions plus rester au Myanmar. Nous avons dû nous sauver.
Les militaires assassinaient brutalement les Rohingyas et brûlaient leurs maisons. Même deux ans avant notre départ en 2017, des jeunes hommes étaient emmenés et torturés. A l'époque, mon fils a eu peur et est parti en Inde. Il est toujours là-bas.
Quand j'ai fui avec mes bébés, nous avons traversé des jungles et des routes boueuses sous la pluie battante pour arriver au Bangladesh. Le voyage a été difficile, surtout avec des enfants. Après avoir atteint la frontière, les gens se reposaient partout où ils pouvaient, mais il n'y avait nulle part où s'abriter. Nous nous sommes assis dans les buissons ou sous les arbres s'il pleuvait abondamment, attendant et espérant de l'aide. Nous mangions tout ce que nous pouvions trouver pour survivre. Mes filles devenaient faibles et vomissaient chaque fois que j'essayais de les nourrir. Elles ont longtemps souffert car il était difficile de trouver des médicaments à notre arrivée.
Quelques jours après notre arrivée [à Cox’s Bazar], des abris en tissu et en bambou ont été construits pour nous. Maintenant, nous vivons ici dans les camps de réfugiés. Mes jumelles ont cinq ans maintenant. Cela fait cinq ans que je vis dans la détresse.
Nous avons un abri, mais au-delà de ça, nous n'avons pas grand-chose pour nos enfants. Nous dépendons de l'aide alimentaire et nous nous inquiétons de savoir avec quoi les nourrir et si c'est suffisant. Nous nous soucions de savoir comment les vêtir et comment les éduquer. Je ne peux pas leur fournir ce dont ils ont besoin car je n'ai pas d'argent.
Parfois, je mange moins que je ne devrais parce que dans mon cœur, je veux vendre le surplus de nourriture pour acheter quelque chose à mes enfants. C'est ainsi que nous vivons – à moitié nourris. Sinon, je ne peux rien acheter à mes enfants.
Parfois, j'ai des nouvelles de mon fils en Inde. Il appelle tous les deux ou trois mois. Je n'ai pas de téléphone portable et je ne peux lui parler que lorsqu'il appelle quelqu'un d'autre. Je ne l'ai pas vu depuis des années et lui et ma maison au Myanmar me manquent terriblement. J'aspire à la paix.
Si jamais nous pouvons vivre à nouveau en paix au Myanmar, nous reviendrons. Pourquoi ne reviendrons-nous pas si justice nous est rendue et qu'on nous accorde la citoyenneté ? N'est-ce pas aussi notre patrie ? Mais comment pouvons-nous revenir si nos droits ne sont pas assurés ? Où vivrons-nous, puisque nos maisons ont été détruites ? Comment pouvons-nous revenir en arrière si nos enfants peuvent être emmenés et assassinés ?
Vous pouvez nous garder ici ou nous transférer dans un autre pays, nous ne refuserons pas, mais je ne retournerais pas au Myanmar sans que justice soit rendue."
J'ai le rêve de devenir médecin, mais je ne pense pas qu'il se réalisera
Anwar, 15 ans, se souvient encore clairement d'avoir fui le Myanmar il y a cinq ans. À la maison, il était un bon élève, il avait des rêves. Maintenant, il est inquiet de la façon dont sa vie va se dérouler.
"Je m'appelle Anwar. Je suis un élève du Myanmar. J'ai 15 ans, presque 16. Nous avons fui notre quartier au Myanmar et vivons maintenant dans le camp de réfugiés de Jamtoli au Bangladesh.
Je me souviens du moment où je me suis enfui du Myanmar avec ma famille. C'était un après-midi, lorsque l'armée a attaqué notre quartier et nous avons dû courir vers une zone voisine. Quand ils ont incendié nos maisons, nous avons dû courir plus loin. Nous avons survécu mais beaucoup de mes proches et de voisins ont été assassinés.
Nous avons parcouru un long chemin pour chercher la sécurité. Je me souviens qu'il a fallu presque 12 jours de course et de marche avant d'arriver au Bangladesh. C'était dangereux : nous avons parcouru des routes inconnues, escaladé des collines et même traversé de l'eau. Nous avons vu beaucoup de cadavres sur le chemin.
Lorsque nous sommes arrivés au Bangladesh, nous sommes restés avec nos parents et nos voisins, et maintenant nous vivons dans cet abri au camp.
J'allais à l'école quand nous nous sommes échappés, alors quand je suis arrivé ici, mes études ont été interrompues. J'étais un bon élève avec de bonne notes. J'aime apprendre, mais maintenant, je ne peux pas étudier ou obtenir les livres dont j'ai besoin.
Seul l'enseignement primaire est disponible dans les camps de réfugiés rohingyas, rien de plus. Notre éducation est bloquée là où nous l'avons laissée. La seule chance d'apprendre c'est lorsque les enseignants de notre communauté rassemblent les enfants rohingyas. Ils nous enseignent avec bon cœur.
Certains de mes amis manquent les cours parce qu'ils sont responsables de subvenir aux besoins de leur famille. Je me sens mal pour eux. S'ils ont la possibilité d'apprendre, ils peuvent enseigner aux autres, cela crée une vague. Ce n'est qu'alors que notre communauté se développera et que notre génération fera le bien.
Mon rêve était de devenir médecin, d'être utile à la communauté. Depuis mon enfance, j'ai vu des médecins aider les gens et faire de leur mieux. Je comprends maintenant que ce rêve pourrait ne jamais se réaliser. Pourtant, je me sens heureux quand je vais en cours et que je rencontre mes amis. Nous essayons d'être heureux tout en étudiant et en jouant.
Notre vie dans le camp n'est pas facile. Ce que mon père gagne n'est pas suffisante pour subvenir aux besoins de ma famille. Et parfois, quand je rentre de l'école le soir, je ne me sens pas en sécurité.
Je voudrais m'adresser aux jeunes comme moi du monde entier. S'il vous plaît, utilisez l'opportunité qui s'offre à vous et apprenez autant que vous le pouvez. Mes compatriotes réfugiés rohingyas et moi n'avons pas une telle opportunité."
Je m'inquiète pour mes enfants et leur avenir
Nabi Ullah, 25 ans, a fui au Bangladesh avec sa famille en 2017. Tous les membres du groupe avec lesquels ils se sont échappés n'ont pas survécu au voyage. Aujourd'hui, cinq ans plus tard, Nabi Ullah et sa femme Nasima réfléchissent à ce qu'il leur faudrait pour pouvoir retourner au Myanmar.
"Au Myanmar, je travaillais comme agriculteur", explique Nabi. « Je cultivais des terres dans les collines et nous nous nourrissions des récoltes. Il n'était pas nécessaire de gagner de l'argent car nous produisions notre propre nourriture."
"Lorsque l'armée est arrivée [en 2017], ils m'ont torturé et laissé inconscient. Mes voisins ont été massacrés et brûlés ; d'autres ont disparu. Ils ont mis le feu à tout le quartier. Nous avions besoin de nous enfuire. J'ai emballé des médicaments, rassemblé mes forces et ma famille, et je suis parti."
"Pendant que nous nous échappions à travers les collines, une dizaine de personnes du groupe avec lequel nous étions ont été tuées", raconte Nasima. "Mon mari, ses parents et moi avons survécu, mais ma famille n'a pas survécu. J'ai perdu mes parents et nous avons dû les laisser derrière nous et traverser la frontière avec le Bangladesh."
"Après avoir traversé la frontière, le gouvernement du Bangladesh nous a donné un abri et de la nourriture, raconte Nabi. Ensuite, nous avons été envoyés dans ces camps. Le Myanmar me manque."
"J'ai un fils et deux filles. Mon fils est né ici à l'hôpital MSF. Il a un an et demi. Mes filles sont nées au Myanmar. Ma femme est maintenant enceinte d'un autre enfant. Nous dépendons de l'aide alimentaire et nous luttons pour payer les autres choses dont nous avons besoin, comme acheter des vêtements pour les enfants. Nous sommes dans une situation désastreuse.
Ici, dans les camps, les gens souffrent beaucoup de fièvres, de diarrhées, de maux de gorge et d'autres maladies. Quand j'attrape de la fièvre, ma gorge gonfle et j'ai du mal à respirer. Une fois, j'ai été emmené à l'hôpital de Kutupalong en ambulance et j'ai été admis pendant trois jours parce que j'avais besoin d'oxygène.
Je vais à MSF chaque fois que je ressens un malaise et j'emmène aussi mes enfants à MSF pour différents types de maux. Je m'inquiète pour mes enfants et leur avenir. Je veux une éducation pour eux. Il n'y a pas de plus grande richesse que l'éducation. La vie ici sera encore plus difficile lorsque nos enfants grandiront sans éducation.
Notre maison nous manque terriblement à tous. Je n'ai même pas envie de manger quand les souvenirs du Myanmar reviennent.
Nous sommes éternellement reconnaissants au gouvernement du Bangladesh de nous avoir soutenus. Remercier le gouvernement qui soutient autant de familles ne sera jamais assez. C'est juste que nous voulons rentrer chez nous. Je pense toujours à ce qui nous aiderait à rentrer au Myanmar.
Nous ne pouvons revenir que si le gouvernement nous accepte en tant que citoyens et rend nos maisons, nos terres et nos documents. Nous voulons aller là où nos droits seront assurés."
Nos abris sont toujours aussi provisoires qu'à notre arrivée
La nuit avant qu'Hashimullah, 45 ans, ne fuie le Myanmar, il s'est réveillé au son des balles. Le lendemain matin, il réussit à s'évader. Cinq ans plus tard, depuis son lit d'hôpital dans l'établissement MSF de Cox's Bazar, ses souvenirs vivaces des scènes de sa fuite lui font se demander s'il sera un jour suffisamment sûr d'y retourner.
"Nous sommes arrivés au Bangladesh en 2017. Nous sommes venus ici parce que les Rohingyas étaient arrêtés et assassinés au Myanmar.
Nos quartiers brûlaient les uns après les autres. Des bombes ont été lancées depuis des avions. Nous avons observé cette situation pendant huit jours, en espérant que les choses se calmeraient. Mais les choses n'ont fait qu'empirer.
Une nuit vers 4 heures du matin, alors que tout le monde dormait, il s'est mis à pleuvoir des balles. Tout le monde avait peur.
Le matin, nous avons vu des cadavres flotter dans les canaux. Certaines personnes étaient encore en vie, mais personne ne s'est approché d'elles. Les militaires se dirigeaient vers la zone où nous nous cachions. Tout le monde avait peur pour sa vie et a commencé à fuir partout où il le pouvait. Tant de Rohingyas ont été massacrés.
Mais même avant 2017, des hommes étaient enlevés, des femmes violées et l'armée prenait notre bétail.
Le jour de notre fuite, un grand nombre de personnes se sont rassemblées à la frontière. Des gens ont envoyé des bateaux du Bangladesh pour que nous puissions traverser en toute sécurité.
Nous étions un grand groupe. De nombreuses personnes se sont noyées en mer sur le chemin du Bangladesh. J'ai survécu au voyage et j'ai atteint Shah Porir Dwip [une île du côté bangladais de la frontière]. De là, nous avons été emmenés à Teknaf [à Cox's Bazar] dans des véhicules fournis par le gouvernement du Bangladesh et la population locale nous a donné de la nourriture et de l'argent.
Ensuite, nous avons déménagé à Kutupalong, où nous avons été affectés à différents camps. Au début, nous n'avions pas de matériaux pour construire un abri. Plus tard, le gouvernement du Bangladesh nous a donné des matériaux pour les abris et nous avons commencé à les construire.
Maintenant, je suis ici depuis cinq ans. Il y a deux ans, je suis tombé malade. Je me sentais étourdi et ressentais une gêne dans ma poitrine. J'ai perdu connaissance et j'ai été amené à l'hôpital de MSF à Kutupalong. Le médecin m'a dit qu'il avait trouvé un blocage dans mon cœur. J'ai suivi un traitement ici pendant 16 jours et mon état s'est finalement amélioré.
Ici, nous souffrons de nombreuses maladies. Nos abris sont toujours les mêmes abris temporaires que lorsque nous sommes arrivés – ils ont enduré des conditions météorologiques extrêmes. Nous avons vraiment besoin de plus de matériaux pour les abris, mais il est difficile d'en trouver avec les restrictions de mouvement dans les camps. Des clôtures ont été érigées et nous ne pouvons plus nous déplacer comme avant.
Le gouvernement nous fournit des denrées alimentaires, et nous sommes reconnaissants pour les choses que nous recevons, mais parfois ce n'est pas suffisant et nous devons essayer d'acheter du poisson.
Certains d'entre nous travaillaient comme pêcheurs au Myanmar et d'autres étaient agriculteurs. Nous nous sommes échappés ici, mais nos cœurs sont toujours là-bas, à la maison. J'habitais au bord de la rivière. J'avais une vie décente car mon entreprise vendait des filets de pêche et mes enfants pêchaient du poisson.
À cette époque, nous étions en sécurité au Myanmar et nous pouvions nous déplacer. Mais nous ne pouvions pas profiter de nos gains à cause de l'armée. Si nous importions et enregistrions cinq vaches, nous devions leur en donner deux.
Nous devions payer 60 000 kyats à l'armée si nos filles devaient se marier. Si quelqu'un souhaitait construire une maison, il devait payer 500 000 kyats pour embaucher un géomètre.
Même si nos cœurs aspirent à y retourner, comment le pouvons-nous si notre sécurité n'est pas assurée ? Si le monde décide que nous pouvons être rapatriés [en toute sécurité], ce n'est qu'alors que nous partirons. Mon seul besoin est le droit de vivre dignement au Myanmar, comme nous le faisons ici. Des millions de Rohingyas veulent jouir de leurs droits et être en sécurité chez eux."
Nous avons été traités comme des parias et la privation progressive s'est transformée en persécution
Mohamed Hussein a travaillé pendant plus de 38 ans comme greffier civil au sein du bureau du ministre de l'Intérieur au Myanmar. En 1982, il a été déchu de sa citoyenneté en raison de son appartenance ethnique Rohingya. Depuis lors, Mohamed a vu ses droits et libertés érodés. Il a été contraint de fuir au Bangladesh et est dans les camps depuis cinq ans.
"J'ai terminé le lycée en 1973. J'ai même eu un emploi d'employé du gouvernement car à l'époque, les Rohingyas étaient reconnus par la constitution. Ils ajoutaient directement après avoir vérifié si nous avions terminé nos études secondaires.
Après avoir obtenu l'indépendance de la domination britannique en 1948, le gouvernement nous a acceptés en tant que citoyens. Si le père de quelqu'un était né au Myanmar et que le fils l'etait également, les deux peuvent être reconnus comme citoyens. Les personnes de toutes les ethnies jouissaient de droits égaux. Personne n'était victime de discrimination.
Tout a changé en 1978, lorsque le recensement de Naga Min, ou OpérationDragon King, a été effectué. Le recensement a déterminé qui était citoyen du Myanmar et qui était bangladais. De nombreuses personnes ont été arrêtées parcequ'ils n'avaient pas les papiers appropriés. Je craignais pour ma vie, j'ai fui. Plus tard, le gouvernement du Myanmar nous a repris. Ils ont conclu un accord avec le gouvernement du Bangladesh, et on nous a promis que si nous revenions, nos droits seraient garantis. Cette promesse n'a pas été tenue. Les terres ont été rendues à leurs propriétaires, mais nos droits n'ont pas été assurés. Ce fut le début de notre oppression. Nous avons été traités comme des parias et la privation progressive s'est transformée en persécution.
Les autorités nous ont retirés notre citoyenneté [au Myanmar]. En vertu de la loi [de 1982] sur la citoyenneté, ils ont reconnu des catégories d'appartenance ethnique et des pourcentages pour chacune ont été annoncés. Cette catégorisation n'existait pas auparavant.
À cette époque, malgré le retrait de notre citoyenneté, les Rohingyas étaient toujours acceptés dans le pays en tant qu'étrangers. Différentes régions diffusent les nouvelles des communautés Rohingyas. Après le coup d'État militaire, notre temps d'antenne radio a été annulé.
Si nous sommes vraiment étrangers, pourquoi l'ancienne constitution ne nous reconnaissait-elle pas comme étrangers ?
Nous n'étions plus autorisés à poursuivre des études supérieures. Des restrictions de voyage ont été imposées et les militaires nous ont accusés d'être impliqués dans un conflit avec les bouddhistes. Des membres réputés de la communauté Rohingya ont été arrêtés ou condamnés à une amende en raison d'allégations d'oppression des bouddhistes. Des couvre-feux ont été décrétés et si quelqu'un était trouvé en train de visiter une autre maison, il était torturé. Alors, nous avons commencé à nous taire quand quelque chose arrivait dans notre communauté.
Chaque année, ils arrivaient avec de nouvelles directives. Ceux qui ne se sont pas conformés ont été arrêtés.
Malgré tout cela, nous pouvions encore voter. Nous avons élu des députés qui ont participé aux sessions parlementaires. Puis, en 2015, même notre droit de vote nous a été retiré.
Nous nous sommes sentis rabaissés et inquiets. Dans le pays où vivaient nos ancêtres, nous ne pouvions plus voter. Nos cœurs se sont brisés quand nous avons été traités d'intrus. Le traitement était si injuste que nous avons dû fuir.
Un matin [en 2017], nous avons entendu des coups de feu. [Ensuite], c'est un jeudi soir que de véritables coups de feu ont été tirés depuis le poste militaire près de chez nous. Le lendemain matin, nous avons appris que des Rohingyas avaient été tués.
Lorsque les gens ont vu les militaires entrer dans notre zone, ils ont commencé à s'enfuir. Nous étions terrifiés, car les militaires arrêtaient et tuaient des gens partout. Courant pour sauver nos vies, nous sommes arrivés ici au Bangladesh. Nous avons eu la chance d'être arrivés ici vivants. Le Bangladesh fait beaucoup pour nous et se tient à nos côtés.
Quand nous sommes arrivés ici, nous avions beaucoup d'espoir. Mais maintenant, nous nous sentons coincés. La vie est devenue difficile. Mon cœur s'agite à cause de cela. Chaque fois que je sors, je suis fouillé [par les gardes].
Je ne peux même pas rendre visite à mes enfants. Une de mes filles vit à Kutupalong et une vit à proximité. Il me faut beaucoup de temps pour atteindre leurs abris lorsque j'essaie de leur rendre visite. Le confinement me dérange.
Je suis inquiet pour notre avenir parce que nos enfants ne sont pas correctement éduqués. Qu'ils restent ici ou qu'ils retournent au Myanmar, que feront-ils sans éducation ? Nous passons de nombreuses nuits blanches à y penser.
Je reçois des soins médicaux pour mon diabète et mon hypertension dans un centre MSF à l'intérieur du camp, mais le traitement de ma maladie rénale n'est pas disponible dans le camp. Je ne peux pas sortir pour obtenir ce traitement, donc j'espère qu'il sera disponible dans les camps.
Je suis vieux maintenant et je vais bientôt mourir. Je me demande si je reverrai ma patrie avant de mourir. Mon souhait est de rendre mon dernier souffle au Myanmar. Je ne sais pas si ce souhait sera exaucé.
Mon cœur aspire à notre rapatriement au Myanmar, avec la garantie que nos droits seront protégés et que nous ne serons plus persécutés. J'ai peur de la possibilité d'être à nouveau confronté à la persécution au Myanmar et puisque nos familles sont là-bas, nous devons penser à leur sécurité.
Nous serions traités de la même manière au Myanmar si nous étions reconnus comme citoyens. Nous devrions pouvoir étudier, mener notre vie et nous déplacer comme n'importe quel autre citoyen du Myanmar. Nous devrions pouvoir voter, participer aux élections et faire entendre notre voix au Parlement.
Maintenant que tous nos droits nous ont été retirés, nous ne sommes plus que des cadavres ambulants. Le monde est fait pour que chacun puisse y vivre. Aujourd'hui, nous n'avons pas de pays à nous bien que nous soyons humains.
Je dis au monde, nous sommes tout aussi humains que vous. Comme nous sommes nés humains, nous souhaitons vivre une vie digne.
Nous demandons au monde de nous aider à vivre en tant qu'humains. Mon souhait est d'avoir des droits et la paix."